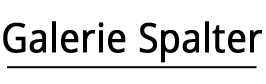Après une longue période expressionniste dans ses débuts où elle se prend comme modèle- « je n’avais que moi sous la main » dit elle - où le corps, le geste, l’expression sauvage, la dépense colorée étaient de mise, Laëtitia Giraud se laisse glisser dans la coulée des processus révélateurs de nouvelles occurrences.
Un travail de transformation s’effectue de part la posture adoptée. Rappelons cette phrase de Picasso « je ne cherche pas, je trouve ». Ce pragmatisme, Laëtitia Giraud l’a fait sien dans sa pratique. Elle s’est laissée envelopper par son travail de peintre entre souffrance et bonheur. L’appropriation consciente ou inconsciente de cet énoncé a véritablement déterminé sa position quant à « son métier » de peintre. Loin de toutes les idéations, les énoncés, les récits, les messages, Laëtitia Giraud laisse parler sa pratique de peintre cousinant avec un certain formalisme. Effectivement, malgré la figuration apparente de sa peinture, nous pouvons dire que Laëtitia Giraud est un peintre « figuratif-abstrait ». Cet oxymore permet de comprendre sa posture et de quelle façon elle perçoit et considère la peinture. Le débat figuration-abstraction n’ayant plus lieu d’être, ses choix vont plutôt à la qualité qu’au genre. Pour mieux comprendre son travail de facture réaliste, dont les coulées dénoncent la peinture, il faut peut être décrire le processus.
Comme tout artiste, Laëtitia Giraud s’est fabriqué des procédures et ce sont ces dernières qui nous permettront de mieux comprendre sa production. À première vue nous avons 3 grands thèmes traités : portrait, nocturne et nu. Cela peut nous paraître déroutant. Quel rapport entre ces 3 thèmes ? peut-être aucun. Sa peinture, malgré la figuration, n’a pas de vocation significationnelle. C’est une œuvre de monstration plutôt que de démonstration (c’est un montré du doigt). Laëtitia Giraud nous invite à partager ses émotions, ce qui du regard la transperce. Laëtitia Giraud débute toujours son travail par un acte photographique qui fixe une impression, une émotion en vue d’une transcription picturale (passée ou pas par la trituration informatique) qui de ce fait s’additionne en couche de sensations, d’émotions, un travail de strates, une archéologie psychique, sur lequel viennent se greffer les titres de certaines toiles. Ces nouveaux champs émotionnels de nature mnémoniques auditive ou narrative qui a priori n’ont rien en commun avec la peinture, outre le lien arbitraire qu’elle établit, se rajoutent aux couches émotionnelles et sensitives déjà présentes (ce que Gilles Deleuze appellerait, bloc d’affect / bloc de percept). Ces blocs, ces conglomérats font sens dans un ouvert à l’infini. Laëtitia Giraud, dans sa posture, s’approprie un moment de l’histoire de la peinture dans la séparation de son assujettissement au récit, à l’instant où le peintre a pris conscience qu’il peignait la peinture et qu’il pouvait envisager la peinture sous forme de sujet choisi. La peinture est ontiquement un être dont la nature et l’essence s’il en est, seraient variables dans le temps. Laëtitia Giraud n’a aucune volonté messianique si ce n’est de nous faire partager le plaisir de son regard.
André Debono